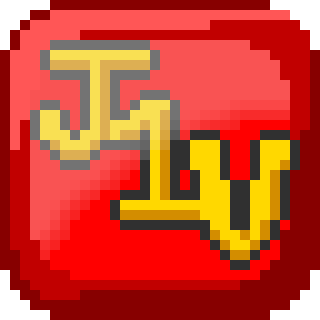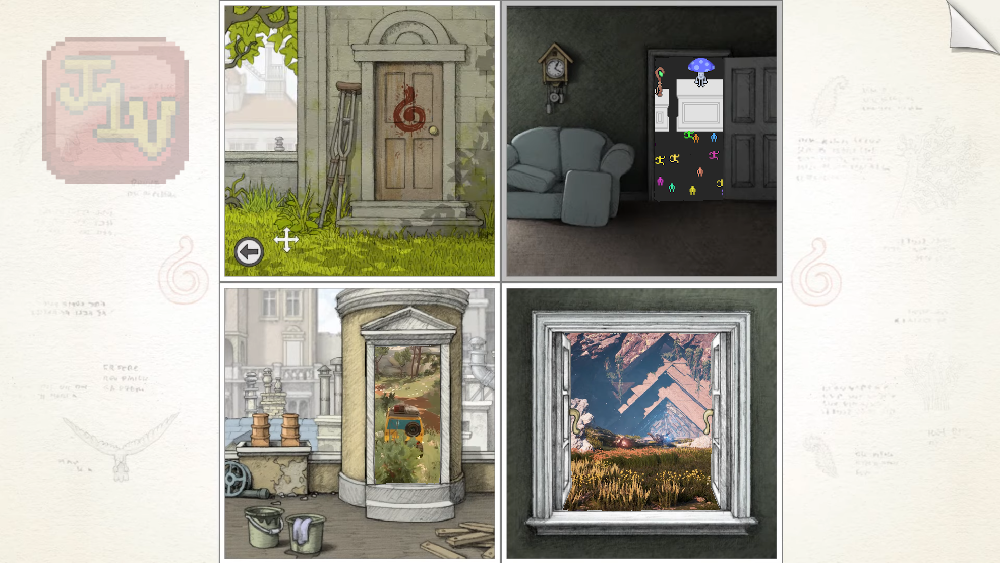Les facteurs qui entrent dans l’appréciation d’un jeu vidéo sont nombreux et très relatifs ; l’apprentissage d’un système de règles touffu sera un jeu d’enfants pour un habitué d’un genre donné, une cadence trop rapide repoussera ceux qui cherchent avant tout la détente, tandis qu’une interaction agréablement minimale selon quelqu’un apparaîtra comme un festival de l’ennui pour un autre. Quant à la beauté, même si les exceptions à cette règle sont de plus en plus fréquentes, il s’agit d’un critère esthétique très souvent lié à l’emploi de la technologie accessible et à certains standards d’époque.
Mais de tous ces aspects, la « profondeur » est sans doute le le plus abstrait. On dit d’un système de jeu qu’il est « profond » lorsque sa mécanique s’avère souple et complexe, allouant au joueur une marge de manoeuvre intéressante. Rarement réfère-t-on par ce terme aux intentions du créateur, à la particularité de la vision du monde que son ouvrage véhicule. Bref, dans la mesure où l’on décide d’attribuer du « sens » à un jeu vidéo, le joueur l’emporte presque toujours.

Ian Bogost, le concepteur de l’étrange chose qu’est A Slow Year, reconnaît cette ambiguïté. Dans un des courts chapitres « préfaçant » son logiciel, il écrit que « le sens ne provient pas de la fixité de l’idée d’un auteur, mais du jeu libre entre les traces que l’auteur a laissé derrière ». À la particularité qu’il ne réfère pas ici au jeu vidéo, mais bien au mouvement « imagiste » de la poésie américaine contemporaine, auquel sont associés des noms comme Ezra Pound et William Carlos Williams. Se fixant des contraintes particulières et suivant ses propres envies, le chercheur de profession s’est donné comme objectif d’explorer cette ressemblance entre les manières « incomplètes » dont se livrent la poésie de type haïku et le jeu vidéo.
Le résultat est déroutant, mais fascinant. A Slow Year est en vérité un rassemblement de petites vignettes programmées sur Atari 2600, représentant une saison chacune. Leur fonctionnement et leurs buts ne sont pas explicitement indiqués, et si l’idée d’un jeu à déchiffrer soi-même a de quoi piquer la curiosité de bien des observateurs (ou les rebuter, c’est selon), elle pourrait tout aussi bien décevoir ceux qui s’attendraient à quelque chose de moins rudimentaire. En effet, le dépouillement total de l’objet complique passablement sa réception ; sa « réussite » relative dépend surtout de l’intérêt que l’on accorde à sa démarche, et de sa volonté personnelle de partager l’expérience du temps qu’il cherche à inspirer.
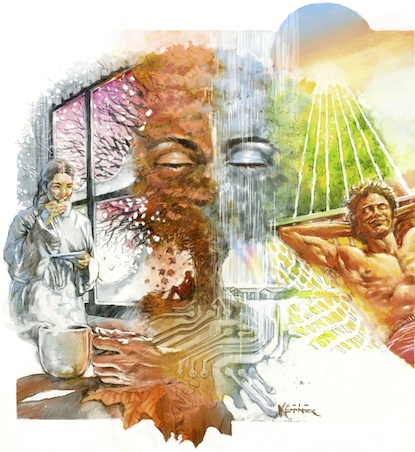
C’est la nature des actions à effectuer qui, plus encore que l’esthétique pixellisée, distingue la chose d’un jeu vidéo traditionnel. Au tout premier niveau, chacun des jeux se résume à patienter plusieurs secondes, réagir à un signal, puis attendre de nouveau. Une idée qui peut sembler risible au premier regard, mais qui dépasse la simple « contemplation de temps morts » par la manière insidieuse dont chacun des objectifs devient curieusement prioritaire. Archi-minimalistes (bien que poussant occasionnellement les ressources de la console antique à ses limites), les quelques touches de dynamisme visuel et sonore ne peuvent faire autrement que d’attirer l’attention, et contribuent toutes au climat à la fois clinique et serein de l’ensemble.
Pendant ce temps, l’impératif de « performer », de maîtriser chacune des mécaniques, demeure entièrement à la discrétion du joueur ; il est tout aussi légitime d’approcher chacune de ces vignettes comme un simple morceau de temps encapsulé, suivant son cours indépendamment de la « compétence » de l’opérateur. Et c’est dans cette ouverture du rapport à l’objet que réside sa beauté: en l’absence de toute autre distraction, la cadence EST le message, le désir de s’y impliquer ou non en disant plus long sur le joueur lui-même que sur le monde qu’il habite. Dans sa reproduction électronique de petites compulsions anodines émergeant de moments d’observation paisible, Ian Bogost semble avoir mis le doigt sur une tendance profondément humaine à chercher du sens et du jeu là où il n’y en a que très peu a priori. Mais j’aurais tort d’imposer cette lecture à un effort qui se définit par ses espaces à remplir.
De son propre aveu, et sans traduction, le seul souhait du chercheur est d’apporter au joueur « a small measure of intrigue and curiosity and delight, for unlike most videogames, poetry has but those humble goals ». Il parle aussi du processus laborieux mais passionnant de conception sur Atari, et de son désir d’en évoquer la lenteur fondamentale. Bref, avec cet essai que d’aucuns pourraient facilement qualifier de « prétentieux », Bogost n’essaie pas de prouver quoi que ce soit ; il se contente de créer à sa guise, pour son propre plaisir d’abord, en espérant toucher quelqu’un, mais sans craindre d’y échouer. Par-delà cette ambition toute simple, c’est la cohérence de la réflexion formelle qui le motive et le détermine, ainsi que l’étrange beauté que dégage son exécution, qui font peut-être d’A Slow Year quelque chose comme un chef-d’oeuvre de design expérimental.